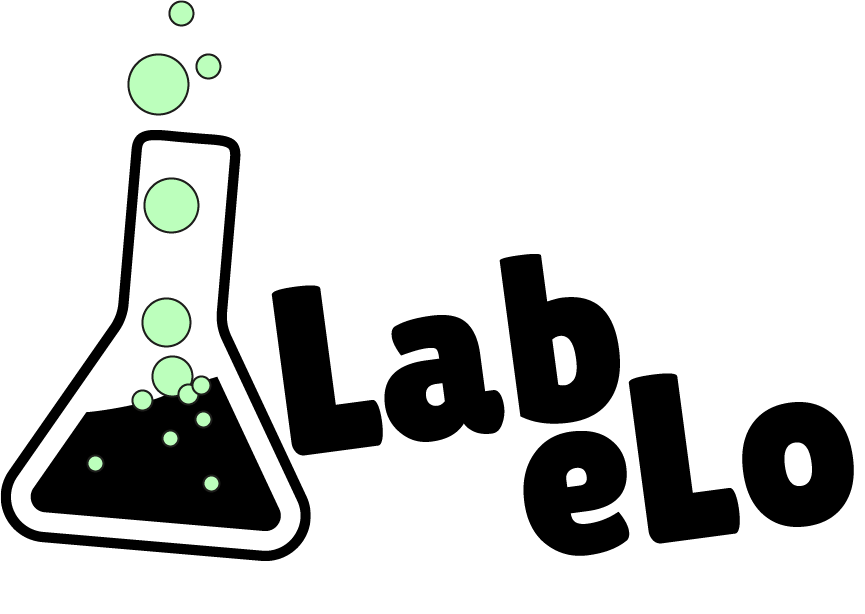
La Boîte à outils
Diriger une structure en transition
comment
ça marche?



Les fiches : comment ça marche ?
La Tool Box eLo se compose de fiches qui recensent des pratiques vertueuses dans les principaux domaines d’activité des institutions culturelles du territoire. Ce sont des outils pratiques qui sont censés vous aider à faire des choix très pratiques…
Elles peuvent être parcourues juste via les grands titres (si ça vous suffit) ou analysées dans les moindres détails (en cliquant sur les triangles).
Pour chaque pratique suggérée, quatre options s’offrent à vous : “déjà fait”, “à faire”, “reporté” ou “pas pour nous”. Il est conseillé d’échanger avec vos collègues et surtout avec votre direction pour vous accorder sur les actions à mettre en œuvre.
Une fois vos choix effectués, vous pouvez générer un PDF personnalisé. Après avoir rempli quelques informations complémentaires, vous obtiendrez un mémo pratique à afficher dans votre bureau, la cuisine ou les couloirs… Ce mémo contiendra uniquement les actions que vous aurez tagué “A faire” (donc celles que vous souhaitez entreprendre à court terme).
Le bouton pour générer le PDF se trouve à la fin des actions possibles.
Des fiches seront ajoutées au fil du temps cette année…
Les institutions culturelles engagées dans la transition écologique et sociale ont nécessairement besoin de l’engagement d’une personne ou mieux, d’une équipe de personnes dont une partie du temps de travail est dédié à la transition.
Mais, même avec ces personnes, sans l’engagement sincère des responsables d’institution, rien ne changera vraiment. C’est pourquoi votre rôle est vraiment décisif. En tant que responsable de la structure, ce sont vos choix, vos discours et vos actions qui vont :
- motiver (ou non) les équipes ;
- soutenir les actions des personnes en charge de la transition (y compris financièrement) ;
- intégrer une dynamique globale de transition dans tous les projets.
De plus, vous seul·e (ou presque) avez la main sur certains points comme les ressources humaines, les finances, le choix des partenaires, le règlement, etc.
Si vous ne vous engagez pas volontairement sur le chemin de la transition, votre institution court des risques (voir par exemple ici) :
- physiques (événements climatiques extrêmes)
- financiers (coût des matières premières, assurances, etc.)
- réglementaires
- de réputation / d’image
- de perte des publics.
Vous pouvez suivre 7 recommandations générales (la plupart sont tirées du rapport du Shift project) :
- Connaitre votre situation particulière et vos besoins spécifiques, via l’évaluation régulière
- Relocaliser une grande partie de vos activités
- Ralentir et sensibiliser les financeurs et partenaires à l’intérêt de ralentir
- Baisser les jauges et sensibiliser les financeurs et partenaires à l’intérêt de baisser les jauges
- Ecodesigner les décors, les costumes, les outils de communication, etc.
- Abandonner les grandes innovations technologiques quand elles n’ont pas de sens pour l’institution
- Collaborer, jouer le collectif plus que la concurrence. Il vaut mieux collaborer avec les autres institutions pour toucher 90% des publics, que se battre avec les autres institutions pour attirer les 10% d’habitués.
Rappels :
- Vous avez jusqu’à 2050 pour atteindre le « zéro émission » (soit environ 80% de baisse de vos émissions de GES). Vos objectifs doivent être progressifs et gérables : ni trop modestes, ni trop ambitieux.
- Ce que vous perdez en temps de réflexion au début, vous le gagnez en efficacité et bien souvent en budget par la suite !
Vous disposez de 4 leviers principaux pour engager votre institution sur la voie de la transition :
- Faire ou demander un état des lieux de la situation
- Puis en fonction, établir une politique globale pour l’institution pour les domaines suivants : les finances, les ressources humaines / la formation, les prestataires et partenaires mais aussi les autres domaines à structurer
- Évaluer les effets des actions réalisées
- Communiquer avec les publics et les partenaires
Surtout, il parait important d’appliquer les recommandations à votre propre travail : vous ne pouvez pas interdire l’avion à vos équipes et le prendre régulièrement.

Si vous ne deviez faire que deux choses :
1) Faire moins : programmer moins, communiquer moins, consommer moins, fabriquer moins… et écoconcevoir ce qui doit être fait.
2) Favoriser la convivialité au rayonnement : accueil des habitant.es et des artistes du territoire, travail sur la médiation, inclusion des personnes éloignées de la culture et des personnes en situation de handicap, etc.
Les leviers d’actions possibles
La première démarche à entreprendre est de mieux connaitre la situation de votre structure, afin d’identifier les chantiers vraiment importants. Ils ne sont pas less mêmes chez vous ou chez votre voisin !
Pour cela, vous pouvez faire ou demander une analyse de l’impact environnemental de votre institution (avec des outils comme Seeds ou un bilan carbone par exemple). Cet état des lieux devrait, dans l’idéal, concerner plusieurs facettes de votre activité et notamment : les bâtiments (énergie, eau…), la mobilité, les achats et déchets, la communication, le numérique, etc.
De toutes les actions listées dans les fiches outils de eLo, quelques points spécifiques reviennent, la plupart du temps, aux responsables des institutions seul·es. Voici donc quelques actions que vous pouvez mener dans ces différents domaines :
En fonction de votre état des lieux, vous pouvez planifier les actions à mener
en commençant par les mesures les plus importantes et en vous fixant des objectifs (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis). Mettez en place un document support pour poser clairement les questions et accompagner la réflexion et surtout la prise de décision des équipes. N’essayez pas d’atteindre 80% de baisse d’émissions de GES en un an ! Planifiez des paliers jusqu’à 2030 dans un premier temps… Il est important de mettre en place des espaces d’échange réguliers autour de ces changements pour partager des difficultés : vous pouvez prévoir de consacrer un petit temps à ce sujet pendant chaque réunion ou bien de mettre en place des réunions fixes.
Ce plan d’action doit absolument intégrer la question des risques qui pèsent sur votre institution. Il s’agit alors de s’adapter aux changements climatiques en cours pour travailler votre robustesse.
Ce rapport du Théâtre de l’Odéon propose un plan d’adaptation autour de 6 axes :
- La gouvernance : intégrer les risques climatiques dans les plans d’activité et marchés publics
- Les conditions de travail : ajuster les horaires, équiper et former les équipes (ventilation, accès à des zones rafraîchies près des zones exposées)
- L’accueil du public : changer les horaires et adapter les jauges, installer des points d’eau, former le personnel à la prévention des malaises dus aux fortes chaleurs
- La production artistique : privilégier les tournées courtes, mutualiser les ressources, préparer des spectacles de substitution
- Le bâtiment : végétaliser, déminéraliser les cours, rénover thermiquement, occulter les fenêtres, remplacer les menuiseries, réfléchir à des usages polyvalents pour les lieux.
- Au-delà des leviers réglementaires et techniques, il s’agit également de travailler à des nouveaux usages sociaux des lieux en transformant les lieux en lieux de fraîcheur et de vie sociale en journée, au-delà du spectacle.
Vous pouvez également planifier régulièrement des études, tous les deux ou trois ans, pour comprendre les impacts environnementaux de vos décisions et réajuster éventuellement le tir.
On peut envisager de publier tous les deux ou trois ans, un petit rapport public sur l’état d’avancement de la politique de durabilité, avec si possible une évaluation de votre bilan environnemental. Pour éviter tout écoblanchiment (greenwashing), il convient de ne communiquer que sur les actions effectivement mises en place (et pas sur les projets).
pour que tout le monde se sente concerné et écouté. Vous pouvez leur faire part de vos engagements, de la raison pour laquelle vous embarquez l’institution dans une phase de changement et surtout les rassurer : les difficultés seront surmontées ensemble ! On peut inclure dans la charte, des éléments éthiques comme la rémunération juste des employés, artistes et externes ; des horaires de répétition qui prennent compte le bien-être des équipes et artistes ; le respect mutuel et le bien-être ; etc. On peut aussi inclure des mécanismes d’échange et de médiation en cas de non-respect de ces éléments. Vous pouvez surtout demander à chaque équipe de discuter toutes les actions possibles présentées dans les fiches-outils d’eLo, et de retenir celles qu’il est possible de mettre en place.
Adhérer à une charte, un label ou une norme
: il en existe beaucoup (voir fiche-outil à venir) pour le secteur culturel. Les chartes, normes et labels vous donnent des directions et permettent parfois d’être accompagné par des expert.es. Certaines sont très exigeantes et d’autres le sont moins : posez vous la question de vos besoins et de ce qui pourrait vraiment vous aider.
Vous pouvez ensuite afficher des recommandations à des endroits stratégiques
(par exemple, les horaires et plans des transports en commun près de la sortie pour les équipes, votre charte à l’accueil pour les publics, des petits gestes pour économiser l’énergie dans la cuisine, etc.).
Vous pouvez enfin intégrer systématiquement les questions et objectifs climatiques / environnementaux et sociaux
dans les communications des départements, les réunions du personnel, l’élaboration du budget et les processus décisionnels…
Des études récentes montrent que les achats, et notamment les achats de matériaux, sont les actions les plus impactantes sur les bilans carbone et environnemental des institutions culturelles. En ce sens, l’écoconception est une philosophie à adopter d’urgence.
Or, si l’écoconception a des impacts sur la technique, vous seul.e pouvez imposer la démarche : sans votre engagement direct, aucune véritable transformation ne pourra voir le jour. Et comme le budget ou la taille du plateau, vous pouvez imposer l’écoconception comme une donnée non négociable du cahier des charges. Ensuite, c’est aussi vous qui pouvez former les équipes et sensibiliser les artistes, les équipes et les partenaires pour chaque production…
Vous pouvez d’abord prévoir une ligne budgétaire spécifique pour la transition.
Mais au-delà d’une « augmentation » de budget, il sera certainement nécessaire de le rééquilibrer : par exemple, prévoir moins d’achats neufs (et donc, moins de budget), moins de créations peut-être, mais plus de temps de travail pour trouver certaines fournitures ou bien une rémunération plus juste des artistes ou intervenant·es. Prendre un temps pour réfléchir à ces réorientations peut vraiment être décisif !
Si cette décision vous revient ou que vous pouvez agir dessus, vous pouvez choisir une banque éthique et responsable
(qui ne finance pas les énergies carbonées). Cette décision pourrait même se faire avec plusieurs institutions du territoire pour pouvoir négocier éventuellement un partenariat ou un mécénat.
La question financière peut aussi intégrer la question des revenus (tarifs d’entrée par exemple).
Il n’y aura pas de transition écologique sans transition sociale. Une réflexion sur une tarification équitable et abordable pour les différents publics est donc indispensable. Par exemple, vous pouvez proscrire les tarifications dynamiques (qui s’adaptent à la demande et qui pénalisent fortement les plus défavorisés), vous pouvez penser à des tarifs plus inclusifs, permettant l’accompagnement gratuit pour les personnes en situation de handicap, etc.
Ne pas accepter le sponsoring d’une institution qui finance ou favorise sciemment des énergies carbonées ou a des pratiques problématiques des points de vue écologique ou social.
Ne les laissez pas s’approprier votre bonne image et vos valeurs. Par ailleurs, les publics ne s’y trompent pas et verraient d’un mauvais œil, un sponsoring non éthique… surtout si vous vantez votre démarche de transition !
La transparence sur les grands équilibres budgétaires de l’institution aux personnels et éventuellement aux publics est un point qui peut être important pour l’image de l’institution
: part d’autofinancement, des apports extérieurs et répartition des charges, reliées à la fréquentation réelle (payants, gratuits, personnes de l’organisation).
Vous pouvez ensuite prévoir de former vos équipes aux enjeux environnementaux et sociaux
(vous pouvez organiser un atelier comme la Fresque du Climat, la Fresque de la Culture, le Puzzle du Climat, l’Atelier 2 Tonnes…) et aussi à des sujets spécifiques, identifiés avec elles (écoconception, numérique ou communication responsables, etc.). Rendre ces formations obligatoires serait idéal. Sinon, vous pouvez aussi mettre en places un système d’encouragement : une heure de congés gagné par formation suivie par exemple. Vous pouvez également mettre en place des systèmes de transmission des connaissances au sein de l’organisation (pas seulement des connaissances sur l’environnement, mais aussi sur le fonctionnement de l’institution). Il s’agiti ici aussi de trouver le moyen de donner de la valeur à la formation et aux connaissances nouvelles. Votre rôle ici est autant d’encourager les équipes que de leur libérer du temps pour se former !
Si une ou plusieurs personnes (un groupe) souhaite(nt) prendre en charge des responsabilités concernant l’écologisation de l’institution, vous pouvez leur dégager du temps pour ce travail. Idéalement, elles devraient disposer d’un budget pour développer des actions (à discuter au sein de l’équipe).
Il peut y avoir une personne responsable, mais le mieux est d’en avoir une dans chaque service, avec une réunion mensuelle entre ces personnes. Il est important que ces missions apparaissent dans la fiche de poste de ces personnes !
Vous pouvez favoriser l’embauche de personnes déjà sensibles à la question de la transition
en incluant :
-
- la mention « la connaissance des enjeux énergie-climat et environnement » dans les compétences appréciées pour toute offre d’emploi ;
- les enjeux de la transition dans les processus RH, et notamment : l’accueil du personnel, les contrats de travail, les objectifs de performance, les examens de développement professionnel… ;
- votre charte interne dans tous les contrats d’embauche.
Vous pouvez aussi veiller à respecter et soutenir la diversité au sein des équipes et des artistes que vous soutenez
(diversité linguistique, d’origines, génétique, de genres, de styles…).
Par exemple :
- Mettre en place une politique d’inclusion pour les personnels en situation de handicap (voir la fiche-outil sur l’inclusion – à venir) ;
- Suivre les recommandations de nombreux rapports : les recommandations de Mosaik pour les artistes en situation de handicap au Luxembourg ; celles du ministère de la Culture en France ; celles de Conseil des arts de Montréal par exemple…
Vous pouvez travailler dans le sens du bien-être des équipes et des artistes. La charte éthique du ministère de la Culture en termes éthiques ou de ASPRO (en termes de tarifs) au Luxembourg peuvent inclure des pistes à suivre !
Par exemple :
- Offrir aux personnels des moyens d’expression sécurisés sur le travail au sein de votre institution ;
- En équipe de moins de 20 personnes, inviter tout le monde (et pas seulement les responsables de services) aux réunions ;
- Exprimer votre gratitude envers vos équipes en fin de chaque projet. Faire des retours bienveillants et justes, faisant place à la reconnaissance de l’échec dans les projets (voir la question du feedback artistique par exemple ici) ;
- Garantir au sein de l’institution l’existence d’une démocratie participative, qui favorise les débats collectifs dans lesquels la participation et l’expression individuelle sont possibles de manière égalitaire ;
- Évaluer les projets, reconnaitre les échecs pour changer les protocoles et encourager les équipes à reconnaitre leurs échecs (il existe des ouvrages et des ateliers sur l’utilisation des échecs, par exemple ici) ;
- Mettre en place un plan de prévention des risques professionnels pour les employé·es (risques physiques et psychosociaux) ;
- Mettre en place des évaluations annuelles individuelles pour avoir un vrai temps d’échange ;
- Tout le monde aide à la mise en place des réunions (y compris les responsables : mise en place des tables, des chaises…) ;
- Partager entre les membres de l’équipe, la fonction de représentation de l’institution dans les endroits de visibilités et de réseau ;
-
Mettre à disposition des artistes, sur votre site, une page « comment proposer des projets » et y indiquer un rétroplanning et surtout, les critères sur lesquels la proposition sera étudiée – ce qui permet aux chargé.es de diffusion de mieux choisir les lieux à contacter ou non…
Vous pourriez essayer de vous ménager des plages de réflexion, à vous et à vos équipes.
Pris.es dans une « roue de hamster », on ne trouve plus le temps de réfléchir sur le sens de nos actions et on se trouve pris dans une production perpétuelle. Il semble important de redonner le temps à la réflexion. Une méthode est de se fixer des plages réservées aux lectures, à la pensée. De combien de temps auriez-vous besoin ? Une heure par semaine ? 5 heures ? La réponse vous revient. Évidemment, cela exige de repenser les priorités…
Pour vous libérer du temps pour penser, vous pouvez discuter à des solutions avec l’équipe. Par exemple :
- mettre à disposition des artistes qui vous sollicitent deux adresses email : une pour les premières propositions et une pour le suivi des dossiers et la négociation ;
- proposer des plages sans accès au portable ou aux écrans ;
- etc.
Vous pouvez d’abord sensibiliser vos partenaires, artistes, publics et élu·es aux enjeux de la transition
en :
- distribuant de votre plan stratégique et de vos rapports d’évaluation de vos actions ;
- demandant aux équipes d’inscrire les enjeux environnementaux dans tous les cahiers des charges des prestataires : vous pouvez inscrire vos dispositions et exigences dans le contrat de prestation de service ;
- faisant pression pour que les infrastructures locales soutiennent l’action environnementale (par exemple, les transports publics et les pistes cyclables, les sites de stockage et de partage, l’accès à une énergie à faible teneur en carbone…).
La coopération est une piste à creuser pour faire évoluer vos modes de travail.
On peut par exemple citer :
- L’instauration d’un travail régulier avec des instituts de recherche et des organisations du secteur privé/tiers pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux (par exemple, Universités du Luxembourg ou de Lorraine)
- L’établissement de liens avec les autres institutions pour échanger des conseils, des formations et un soutien sur les impacts environnementaux et les questions pertinentes dans le domaine des arts ;
- Mais aussi pour mutualiser le matériel, partager les frais ou la présence des artistes sur le territoire, etc.
Vous pouvez enfin travailler dans le sens du bien-être des artistes.
- Offrir aux artistes invité·es des moyens d’expression sécurisés sur le travail au sein de votre institution ;
- Respecter le travail de l’artiste, de ses droits d’auteur·es et sa rémunération équitable (voir recommandations tarifaires de l’Aspro pour le Luxembourg) ;
- Mettre en place un plan de prévention des risques professionnels pour les bénévoles (risques physiques et psychosociaux) ;
- Exprimer votre gratitude envers les artistes en fin de chaque projet. Faire des retours bienveillants et justes, faisant place à la reconnaissance de l’échec dans les projets ;
- Mettre en place un plan de prévention des risques professionnels pour les artistes (risques physiques et psychosociaux) ;
- Affirmer le rôle de lien social que joue l’institution, en affichant par exemple un manifeste d’engagement ou en en parlant dans les médias ou avec les partenaires sociaux ;
- Mettre en place une politique d’inclusion pour les personnels en situation de handicap (voir la fiche-outil à venir sur l’inclusion) ;
- Mettre en œuvre d’une charte du bénévolat, précisant les engagements respectifs.
Enfin, de nombreux autres domaines méritent aussi votre soutien :
- Une programmation plus locale, ralentie, moins fondée sur la création et avec des tournées plus cohérentes ;
- L’inclusion des principes de l’économie circulaire dans la politique et la stratégie culturelle ;
- L’écoconception des costumes, décors ou scénographies ;
- La politique de communication et du numérique ;
- La politique d’achats ;
- La politique d’inclusion pour les personnels, artistes et publics…
Des fiches-outils sur chaque thème sont en cours… Même si les actions sont à mettre en place au sein de chaque service, c’est toujours à vous d’impulser et de soutenir les grandes lignes dans chaque domaine.
- Les dispositifs mis en place sont-ils efficaces ? sont-ils bien perçus en interne / par les publics ?
- D’autres dispositifs seraient-ils à mettre en place ?
- Quels sont les co-bénéfices de ces changements en termes de collaborations avec les institutions du secteur, de nouveaux prestataires, de relation avec les publics
La transition écologique et sociale est un chemin qui ne se résume pas à des petits gestes. Elle nécessite un grand nombre de changements dans les pratiques et les valeurs. Il est donc nécessaire de communiquer sur d’éventuels changements ou restrictions, qui pourraient être mal perçues par les personnels et d’ouvrir la possibilité d’un dialogue.
des actions
"A faire"


Je personnalise mon PDF avec mon nom et mon logo (c'est facultatif) :
J'upload mon logo
(taille recommandée : 2 Mb)
Les BA de nos voisins
Si la plupart des structures culturelles s’engagent dans la mise en place de « petits » gestes, celles qui s’orientent vers une réorientation complète sont plus rares ! On peut quand même citer, parmi les plus « engagées » :
- le Palais de Tokyo à Paris, dont le responsable Guillaume Désanges a écrit son Petit Traité de Permaculture Institutionnelle, qui réunit tous les principes d’un changement global. Il vaut pour les centres d’expos mais aussi en grande partie pour les autres structures.
- Le festival Panorama de Morlaix, dont le responsable Eddi Pierres a osé réduire la jauge et relocaliser la programmation. Il a d’ailleurs expliqué à eLo cette réorientation et ses impacts, ici !
Dans le territoire, on peut citer aussi par exemple :
- La Kulturfabrik a lancé sa charte Green Kufa, dès 2013. Les actions sont mises en place par une équipe à l’interne. L’environnement, comme la diversité apparaissent aussi comme des axes forts de sa stratégie.
- Le Escher Theater travaille sur la médiation et la diversité des publics mais mise aussi sur la rediffusion de spectacles, la création locale, etc. Il a aussi mis en place une équipe Ecoresponsabilité.
- La Nuit de la Culture et les Francofolies ont mis en place une charte qui liste des actions à mettre en place dans la participation des habitants (avec les Grands Rêveurs), la mobilité, l’alimentation, les économies d’eau et d’énergie, etc. avec une équipe responsable.
- La Escher Bibliothéik inclut dans sa stratégie autant des actions sur l’accessibilité que sur l’environnement.





