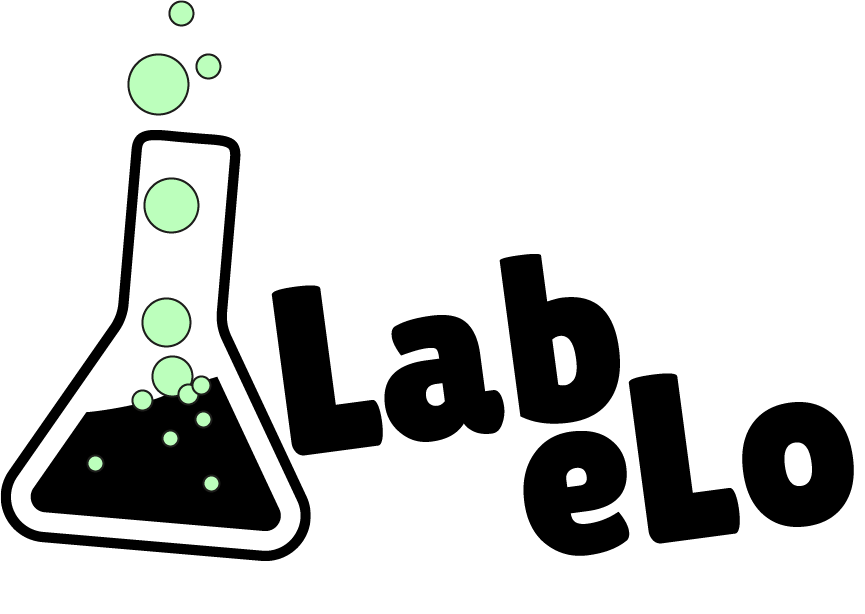
La Boîte à outils
La mobilité des publics
comment
ça marche?



Les fiches : comment ça marche ?
La Tool Box eLo se compose de fiches qui recensent des pratiques vertueuses dans les principaux domaines d’activité des institutions culturelles du territoire. Ce sont des outils pratiques qui sont censés vous aider à faire des choix très pratiques…
Elles peuvent être parcourues juste via les grands titres (si ça vous suffit) ou analysées dans les moindres détails (en cliquant sur les triangles).
Pour chaque pratique suggérée, quatre options s’offrent à vous : “déjà fait”, “à faire”, “reporté” ou “pas pour nous”. Il est conseillé d’échanger avec vos collègues et surtout avec votre direction pour vous accorder sur les actions à mettre en œuvre.
Une fois vos choix effectués, vous pouvez générer un PDF personnalisé. Après avoir rempli quelques informations complémentaires, vous obtiendrez un mémo pratique à afficher dans votre bureau, la cuisine ou les couloirs… Ce mémo contiendra uniquement les actions que vous aurez tagué “A faire” (donc celles que vous souhaitez entreprendre à court terme).
Le bouton pour générer le PDF se trouve à la fin des actions possibles.
Des fiches seront ajoutées au fil du temps cette année…
Pour venir assister à nos spectacles, expositions ou événements, les publics doivent évidemment se déplacer. En France comme au Luxembourg, les loisirs et la culture sont la troisième cause de mobilité. Or, la plupart du temps, c’est en voiture qu’on se déplace, et ce même sur des petits trajets.
Cela pose trois problèmes :
– La mobilité des publics génère des gaz à effet de serre nocifs pour le climat ;
– Elle pollue (particules fines) l’air, les sols et surtout l’eau, ce qui est un problème pour notre santé ;
– Le pétrole se raréfie, les prix des énergies augmentent. Les déplacements risquent d’être réduits aux activités « essentielles ». Les publics seront-ils toujours au rendez-vous dans 20 ans ?
L’empreinte de la mobilité des publics sur le bilan environnemental des institutions est souvent le premier poste. Mais elle dépend surtout de la jauge de l’institution et de sa situation géographique (ville, périphérie, campagne).
À titre indicatif et en moyenne, les déplacements des publics peuvent représenter :
– 99% du bilan carbone d’un grand musée international
– 88,4% du bilan carbone d’une salle de cinéma de périphérie.
– 50% du bilan carbone d’un festival comme les Vieilles Charrues,
– Mais 12% du bilan carbone d’une salle de spectacles moyenne (environ 1.000 places) en périphérie.
Les référentiels carbone du ministère de la Culture français (2025) estiment à 38% l’impact carbone du déplacement des spectateurs du secteur de la création artistique (arts visuels et arts du spectacle).
Quelques points de repères sur la voiture :
– La pollution automobile tue chaque année trois millions de personnes sur la planète, soit trois fois plus que les accidents ;
– Faire un voyage seul·e en voiture thermique peut émettre autant de GES que l’avion (selon le modèle de voiture) ;
– Dans notre territoire Alzette-Belval, jusqu’à 36% des trajets de moins d’un kilomètre sont faits en voiture.
Rappels :
– Vous avez jusqu’à 2050 pour atteindre le « zéro émission » (soit environ 80% de baisse de vos émissions de GES). Vos objectifs doivent être progressifs et gérables : ni trop modestes, ni trop ambitieux.
– Les émissions de GES ne sont pas le seul problème de la mobilité : attention aussi à la pollution, l’artificialisation des sols, la disparition de la biodiversité…
– Ce que vous perdez en temps de réflexion au début, vous le gagnez en efficacité et bien souvent en budget par la suite.
– La mobilité est un sujet très sensible pour les publics parce que la voiture est un symbole de liberté. Des efforts de communication vraiment importants doivent être fait pour accompagner vos efforts dans ce domaine. Collaborez donc toujours avec des spécialistes en communication pour élaborer votre plan.
Vous disposez de six leviers pour installer peu à peu de nouvelles mobilités pour les publics :
-
Faire un état des lieux de la situation et en fonction…
-
Réduire la demande (la « sobriété »)
-
Inciter à prendre moins la voiture et plus d’autres modes de transport (c’est le « report modal »)
-
Améliorer le taux de remplissage des voitures des publics
-
Évaluer les effets des actions réalisées
-
Communiquer avec les publics et les partenaires

Si vous ne deviez faire que deux choses concernant la mobilité des publics, ça serait :
- Faire moins de gros événements qui attirent les publics lointain ;
- Inciter les publics à opter pour des mobilités faiblement carbonées (train, covoiturage…).
Les leviers d’actions possibles
La première démarche à entreprendre est de mieux connaitre la situation des publics de votre structure. Pour cela, vous pouvez :
-
faire une étude sur la mobilité des publics, sur deux ou trois spectacles ou événements différents (voir outils dans la Boite à outil à la fin de cette page) ;
-
faire un état des lieux de votre situation et de vos leviers d’action possibles (voir outils dans la Boite à outil à la fin de cette page) ;
-
en tirer des leçons sur vos priorités et sur vos leviers d’actions possibles, que vous pouvez choisir parmi les suivantes.
En fonction de cette évaluation, vous pouvez mettre en place les premières mesures, en choisissant les plus simples et efficaces parmi les suivantes :
Limiter la jauge des spectacles ou événements et l’assumer publiquement.
Toutefois, il faut veiller à ce que l’accès soit garanti à tous les publics et pas seulement aux plus favorisés.
Accueillir moins de spectacles ou d’événements.
Sans être trop radical – dans la mesure où le secteur souffre déjà et pourrait souffrir encore plus dans les années à venir – on pourrait arbitrer au cas par cas en cherchant une baisse progressive du nombre de spectacles ou du moins, une baisse progressive des besoins de déplacements pour les publics (par exemple, vous pouvez arbitrer en interne une baisse du nombre de représentations ou d’événements de 5% tous les deux ans). Des mesures de compensations pour les artistes devraient être prises en parallèle (rémunération plus juste, conditions de production améliorées…).
Systématiser la mutualisation des tournées, des expositions, des diffusions entre plusieurs partenaires locaux
ou situés sur un même parcours de diffusion afin de garantir un accès plus proche aux publics. Vous pouvez utiliser CooProg pour mutualiser des projets en Europe. Il faut pour cela accepter qu’une partie des représentations accueillent potentiellement moins de spectateurs. La mise en place de partenariats avec des institutions du territoire compense largement la perte de publics par la richesse des échanges. Le rôle de la médiation peut aussi être affirmé pour attirer des publics habituellement éloignés. La première année, essayez de mutualiser trois spectacles / événements / expositions avec des institutions du territoire. Si c’est un succès, mutualisez de plus en plus.
On peut viser par exemple une baisse de x% des publics venus seuls en voiture sur une année.
Ce n’est pas une mince affaire et ça prend du temps. Au moins 3 à 5 ans pour que les pratiques changent. Les principaux leviers pour convaincre les publics de ne plus venir en voiture sont : l’économie réalisée, la fiabilité des autres moyens de transport (vous n’allez pas vous retrouver au bord de la route !), la sécurité et la convivialité.
Pour cela, on peut :
Adapter les horaires de spectacles ou répétitions pour qu’ils soient compatibles avec les derniers trains / bus.
Augmenter les prix des parkings voiture.
Offrir des navettes pour vos événements importants
, si votre étude sur la mobilité des publics le justifie, avec une part importante de publics venant d’un endroit en particulier par exemple. Le coût d’une navette est en moyenne à 5 ou 6 euros par km.
Faire du trajet en navette un spectacle
, en organisant des lectures ou des échanges avec des artistes qui le souhaitent
Proposer des parkings et des services vélos (ateliers réparation, etc.) et sécuriser un maximum l’espace pour les vélos.
Vous pouvez aussi installer des casiers pour les casques (et bien l’annoncer dans votre communication : venir avec un casque peut être un frein au choix du vélo pour les publics).
Fédérer / sécuriser les piétons
: demander à des bénévoles de raccompagner des publics ou bien organiser le co-piétonnage ou co-vélo avec des panneaux à remplir (et là aussi, bien le signaler dans votre communication).
Baisser les prix ou offrir des récompenses (visite des coulisses par exemple) pour les personnes venues en transports en commun, à pied ou en vélo.
Communiquer sur les autres possibilités de transport
: afficher les horaires et plans de train ou encore des « isochrones » qui comparent les temps de trajet en fonction de différents moyens de transports.
Communiquer sur le coût carbone de la voiture
(sans toutefois culpabiliser les spectateur·rices) et sur les autres possibilités qui s’offrent à eux.
Proposer et organiser des fresques du climat et/ou de la mobilité pour vos publics intéressés.
Négocier avec des institutions du territoire et les chemins de fer ou prestataires de bus, pour mettre à disposition des publics plus de possibilités de les utiliser.
Il faut le faire en groupe, pour avoir plus de poids. Surtout, il faut montrer que la Culture contribue à la politique des transports. En revanche, la mise à disposition d’un train coute cher. Oubliez cette solution pour des flux de moins de 2000 personnes attendus.
Inciter à d’autres moyens de transports au moment de l’achat du billet.
Par exemple, quand un.e spectateur.rice achète un billet en ligne, lui proposer de venir en co-voiturage ou co-piétonnage par exemple.
Favoriser et organiser le co-voiturage
: installer sur place, un panneau qui met en relation des publics qui souhaitent covoiturer (voir la boite à outils de Dédé, en bas de cette page).
Vendre des places en lots avec des avantages financiers pour la personne qui conduit.
Organiser, avec les structures de votre territoire, un service de covoiturage culturel en ligne
: ça peut être l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes passionnées par la culture et de construire ou renforcer des communautés ! Vous pouvez par exemple organiser avec les autres institutions du territoire, un système qui permet, dès la vente des places sur Internet, d’organiser le co-voiturage des spectateur·rices (c’est un projet à moyen terme, qui réclame de la coordination et un budget assez conséquent).
-
Les dispositifs mis en place sont-ils efficaces ? sont-ils utilisés ? sont-ils bien perçus ?
-
D’autres dispositifs seraient-ils à mettre en place ?
-
Quels sont les inconvénients et co-bénéfices de ces changements en termes de collaborations avec les institutions du secteur, de nouveaux prestataires, de relation avec les publics ?
La mobilité est un point sensible pour les publics mais important pour nous. Il est donc nécessaire de communiquer sur d’éventuelles restrictions, qui pourraient être mal perçues par les publics et d’ouvrir la possibilité d’un dialogue.
des actions
"A faire"


Je personnalise mon PDF avec mon nom et mon logo (c'est facultatif) :
J'upload mon logo
(taille recommandée : 2 Mb)
Les ressources
- Le rapport Décarbonons la culture
-
Mesurer et communiquer sur l’impact des mobilités dans la culture du ministère de la Culture en France
- Un bulletin de l’amcsti
Les BA de nos voisins
Le NEST Théâtre (Thionville) a mis en place, du 24 juin au 1er juillet 2025, des bus pas comme les autres pour les frontalier.ères entre Thionville et Luxembourg : trois comédien.nes vous accompagnent au travail pour un spectacle matinal gratuit…
Les Francofolies Esch-sur-Alzette mettent en place :
- des navettes en provenance des grandes villes environnantes (Arlon, Metz, Nancy, Thionville) ;
- des horaires des trains du Luxembourg étendus, une communication sur le covoiturage ;
- des parking vélos ;
- des bornes Vélo’k ;
- des départs groupés en vélo depuis les villes environnantes en collaboration avec la Vélorution ;
- le site recense les accès pour les personnes en situation de handicap.
Le Festival No Logo organise par exemple cette plateforme pour encourager les publics à covoiturer !


La boite à outils de DéDé
Ce qui suit est une ébauche d’outils pour vous aider à mettre en place ces actions. Ce ne sont que des propositions indicatives. Si vous en avez les moyens financiers et humains, faites-vous aider par des professionnel·les de l’évaluation, des études, de l’environnement, etc. Là aussi, tant que faire se peut, il vaut lieux privilégier le savoir-faire local !




