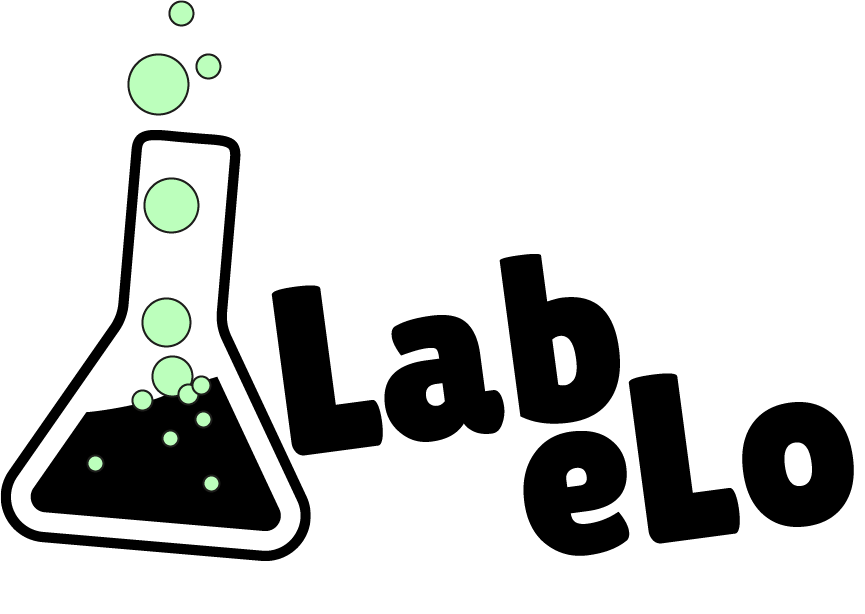
La Boîte à outils
Entretenir de bonnes relations entre artistes et institutions
comment
ça marche?



Les fiches : comment ça marche ?
La Tool Box eLo se compose de fiches qui recensent des pratiques vertueuses dans les principaux domaines d’activité des institutions culturelles du territoire. Ce sont des outils pratiques qui sont censés vous aider à faire des choix très pratiques…
Elles peuvent être parcourues juste via les grands titres (si ça vous suffit) ou analysées dans les moindres détails (en cliquant sur les triangles).
Pour chaque pratique suggérée, quatre options s’offrent à vous : “déjà fait”, “à faire”, “reporté” ou “pas pour nous”. Il est conseillé d’échanger avec vos collègues et surtout avec votre direction pour vous accorder sur les actions à mettre en œuvre.
Une fois vos choix effectués, vous pouvez générer un PDF personnalisé. Après avoir rempli quelques informations complémentaires, vous obtiendrez un mémo pratique à afficher dans votre bureau, la cuisine ou les couloirs… Ce mémo contiendra uniquement les actions que vous aurez tagué “A faire” (donc celles que vous souhaitez entreprendre à court terme).
Le bouton pour générer le PDF se trouve à la fin des actions possibles.
Des fiches seront ajoutées au fil du temps cette année…
Maintenir une relation la plus saine possible entre équipes des structures et équipes artistiques, c’est aussi une manière de faire de la culture durable !
S’il n’existe guère d’alerte globale sur la fragilité ou les limites de la collaboration artistes-institutions, en revanche quantité de collectifs et réseaux réunissant des artistes et/ou des structures de diffusion se sont emparés de ce sujet, à travers différents angles d’attaque :
- Les réflexions sur la parité de genre (souvent dite « égalité femmes-hommes ») dans la programmation sont régulièrement, et depuis longtemps, portées à la connaissance publique ;
- Les dénonciations de violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) émergent, avec des moyens très limités, à la suite de la vague #Metoo initiée dans le monde du cinéma ;
- Les réflexions sur les RPS commencent tout juste à émerger dans le secteur culturel ;
- La situation économique précaire des artistes-auteur·rices est, quant à elle, très bien documentée.
Par ailleurs, les préconisations de bonnes pratiques disent, en creux, les problèmes rencontrés par les artistes avec les institutions.
Il est donc nécessaire de prendre en compte la complexité des relations entre artistes et institutions et leurs enjeux multiples :
- Économique ;
- Rapport de pouvoir économique, de classe, d’influence dans le monde de l’art, de genre, de race sociale, de situation par rapport au handicap, à la grossophobie, à la santé mentale ;
- Lien parfois étroit avec les relations privées voire intimes.
Même si tous·tes les acteur·rices du secteur se sentent précaires d’une manière ou d’une autre, il y a tout de même, au sein d’une collaboration, une asymétrie de pouvoir (au moins en termes d’argent ou d’influence).
Un conseil : aborder l’amélioration des relations par l’un des angles pour démarrer, en ayant en tête la pluralité des angles d’approche.
Pour aborder ce sujet, les angles d’attaque sont pluriels (à l’image de la problématique elle-même…) :
- Améliorer la rémunération nette des artistes ;
- Expliciter les attentes des un·es et des autres vis-à-vis de ses interlocuteur·rices ;
- Aborder les questions d’ordre plus « privé » mais qui impactent la collaboration : addictions, famille, identité de genre.
Pour être efficace, toute action doit être structurée autour de ces grandes étapes :
- Faire un état des lieux
- Lancer les actions possibles
- Communiquer dessus, en interne comme en externe, mais surtout auprès des personnes concernées
- Les évaluer.

Si vous ne deviez faire que deux choses, ce serait :
- Soumettre un rapide questionnaire de feedback auprès des équipes artistiques accueillies / des institutions accueillantes : 3 questions fermées maximum + un champ de commentaire libre.
- Planifier des temps pour l’analyse de ces retours et la mise en place des actions d’amélioration nécessaires.
Les leviers d’actions possibles
Avant toute chose, il est important de savoir d’où l’on part !
Cette étape est fondamentale et doit solliciter l’ensemble des équipes et collaborateur·rices de la structure, même les personnes qui ne sont pas en relation directe avec les artistes.
L’implication des équipes peut être progressive et différentiée selon les sujets abordés. Solliciter d’abord les personnes les plus volontaires permet de lancer un mouvement qui peut s’étendre peu à peu à toutes les équipes.
Fixer des critères de qualité de la relation avec les artistes / les institutions, des moyens de mesurer ces critères et mettre en place un planning d’amélioration continue
:
- C’est-à-dire au moins un·e référent·e dans l’équipe (c’est mieux qu’il y en ait plusieurs) et des temps réservés pour l’analyse et la mise en place d’actions en conséquence ;
- Exemple de moyen de suivre ces critères : recueillir la parole des artistes accueilli·es via un court questionnaire anonyme, de 3 questions fermées maximum (réponse de 0 à 5) + une question ouverte ou un champ pour un commentaire libre (il existe d’autres outils possibles sans la Boite à Outils).
- Attention : les critères de qualité ne doivent pas prendre le pas sur l’expérience vécue. S’ils ne sont pas adaptés, ne pas hésiter à les revoir !
Étudier les expériences passées
:
- Y a-t-il eu des frictions, des malentendus voire des conflits ?
- Une réflexion sur ces frictions, la mise en place de mesures pour y remédier, la trace de ces mesures et leur application ?
- Toutes les personnes en contact avec les équipes artistiques ont-elles formulé leur expérience de ces frictions ?
Étudier les documents écrits utilisés avec les artistes :
- Sont-ils clairs ?
- Sont-ils suffisants ?
- À chaque étape de la relation avec les équipes artistiques, les informations nécessaires sont-elles facilement disponibles ?
- De quand date leur dernière mise à jour ?
Cela semble évident mais c’est une condition sine qua non pour amorcer une bonne relation entre les artistes et les institutions qui les accueillent.
Se documenter sur les préconisations et la législation en matière de rémunération des artistes.
- Il peut être utile pour cela de croiser différentes sources : les associations et syndicats d’artistes, pratiques de pairs, grilles et référentiels proposés par les réseaux territoriaux… (voir la section ressources).
- Une référence au Luxembourg : les recommandations tarifaires d’ASPRO et la Charte de Déontologie du Ministère de la Culture.
- Côté français, il existe de nombreuses références, comme pour les arts chorégraphiques et les arts du spectacle vivant et l’audiovisuel ou pour la musique….
S’il est nécessaire d’augmenter les rémunérations proposées, idée de plan d’action
:
- Créer des échelons d’augmentation sur les x prochaines saisons ;
- Sensibiliser ses partenaires financiers à une juste rémunération ;
- Arbitrer sur les coupes à d’autres endroits du budget ;
- Adapter sa programmation en conséquence. Oui, réduire la voilure si cela permet de mieux rémunérer les artistes, ça fait partie des solutions possibles !
D’une institution à l’autre et d’une équipe artistique à l’autre, les attentes des un·es et des autres diffèrent. D’où la nécessité de formuler, et même expliciter ce que l’institution attend des équipes artistiques avant, pendant et parfois après la collaboration. Le contrat peut être l’endroit de cette clarification, mais aussi toute documentation transmise aux artistes et aux équipes artistiques en amont de la signature même du contrat.
Les attentes peuvent toucher à plusieurs aspects de la collaboration :
Les différents temps de la prestation artistique « en elle-même »
, y compris les représentations, générale, vernissage, visites presse, temps de répétitions ou de montages, etc.
La présence requise des artistes en dehors de la représentation
:
- dates et horaires précis, lieu si hors de l’institution
- type d’événement : événement ouvert au public ; rendez-vous presse ; entre institutions…
- sujet de l’événement : présentation de saison ; performance par d’autres artistes ; atelier d’éducation artistique…
- type de public attendu : “tous public” ; presse ; élu·es local·es ; abonné·es ; familles de tel service de la ville ; enfants de tel âge accueilli en telle institution médicale…
- type d’intervention attendu de la part des artistes — la simple “présence”, ce n’est pas assez précis. Est-ce qu’il faudra répondre à des questions de journaliste ? Répondre à des questions de néophytes curieux·ses. Participer à une table ronde sur un thème prédéfini ? Préparer une présentation de son travail ? Est-ce une conférence sur un thème précis ? Etc.
Des informations précises sur le contenu des œuvres, même si ça « gâche » l’effet de surprise
:
- En effet, les scènes de nudité, la simulation de violences, l’utilisation d’animaux vivants ou morts, un fort niveau sonore, des effets lumineux stroboscopiques, des actes sexuels, la mention d’actes illégaux… : un tas d’éléments peuvent mettre en difficultés les équipes en relation avec les publics (communication, relations publiques, agent·es de billetterie, hôtes et hôtesses d’accueil, agent·es de sécurité, médiateur·rices culturel·les…).
- Même si l’effet de surprise fait partie de la démarche artistique, il est nécessaire d’en parler aux personnes qui incarnent l’institution face aux publics. Ce sont ces personnes qui recevront de plein fouet les les retours de personnes choquées, mécontentes ou autre. Leur permettre de s’y préparer, c’est une manière de respecter leur travail.
Et c’est à l’institution accueillante de préciser tout cela aux artistes.
Toutes les équipes artistiques n’ont pas les mêmes besoins. Si le rôle des institutions semble clair d’un point de vue très global, il est nécessaire d’essayer de formuler dans le détail les attentes d’une équipe artistique vis-à-vis de l’institution qui l’accueille.
- Cela peut se faire dans le contrat ou dans toute autre documentation que l’équipe artistique fournit à l’institution en amont de la collaboration, archivé in fine en annexe du contrat.
- On peut prendre exemple sur la pratique des riders, courante dans spectacle vivant, et l’étendre à toutes les disciplines : même un·e philosophe accueilli·e dans une bibliothèque peut avoir un besoin particulier, et apprécier qu’on s’en inquiète !
Réaliser un tel document d’information.
Voici quelques exemples de demandes à formuler clairement :
- La présentation à des professionnel·les, élu·es, types de publics, artistes… ;
- Être cité·e de telle manière dans la presse, la communication, etc. ;
- Des retours sur le travail artistique, sur les supports de présentation, à chaud ou à froid ;
- D’être sollicité·e / contacté·e de telle manière — canal de communication privilégié, dans telle temporalité — jours et horaires privilégiés ;
- Toute adaptation nécessaire lié à une condition physique :
- Régime alimentaire ;
- Besoin de supports d’accessibilité sensorielle ;
- Besoins pour l’accessibilité motrice ;
- etc. !
Et cela, durant toute la collaboration…
Il peut s’agir de tabac, alcool, médicaments, calmants, drogues “douces” ou “dures”, légales ou non.
- Est-ce que c’est toléré dans un certain cadre ?
- Est-ce qu’il y a des outils de réduction des risques à disposition ?
- Est-ce que c’est formellement interdit ?
- Quelles sont les mesures de contrôle et les conséquences en cas de manquement ?
Mettez-vous à la place d’un·e artiste ou une équipe artistique qui vient présenter une œuvre, loin de chez lui/elle. Iel ne connaît pas les lieux, est fatigué·e et vient de traverser plusieurs villes – voire pays – en quelques jours, voire qui ne parle pas forcément les langues parlées ici.
Ce document doit être rédigé en langage facile à lire et à comprendre (FALC), comporter plans et pictogrammes clairs, et faire l’objet d’une amélioration continue. Il peut être utile de l’enregistrer en audio également.
Il pourrait contenir :
Les infos pratiques et technique sur la ou les salles
: matériel disponible, points d’eau potable, prises, issues de secours, lumière naturelle ou non…
La présentation des membres de l’équipe de l’institution
utiles à connaître pour les artistes :
- prénoms noms
- pronoms
- téléphone et adresses email
- photo
- fonctions ou types de services et infos qu’iels peuvent délivrer aux artistes
- etc.
Un plan du bâtiment, avec les infos précieuses
:
- toilettes
- espace fumeur·ses
- catering
- foyer des artistes
- machines à laver
- bureaux des interlocuteur·rices utiles
- espaces accessibles au public
- …
Un plan du quartier ou de la ville, avec par exemple
:
- des infos sur les transports publics
- relais taxi
- commerces utiles alentour
- espaces verts
- …
Avec toute info sur l’accessibilité physique
(escaliers, ascenseurs, rampes d’accès…), comme on le ferait pour les espaces accueillant des publics !
Dégenrer la langue, à l’écrit comme à l’oral. La langue doit être inclusive, avec ou sans point médian :
- Utiliser la double flexion : la comédienne et le comédien, il et elle, elles et eux ;
- Les termes épicènes : les personnes, les artistes ;
- Les noms collectifs : le groupe, l’équipe ;
- ou encore les néologismes tels que : toustes, les producteurices, les ingénieureuse du son.
Et cela, aussi bien quand on parle d’un groupe mixte que quand on parle à ou d’une personne dont on ne connaît pas l’identité de genre.
Passer en revue toutes les mentions de genre dans les documents contractuels et de communication
et les faire disparaître. Exemple : « Des protections menstruelles sont à disposition pour les femmes » devient : « Des protections menstruelles sont à disposition pour les personnes qui en ont besoin ».
S’il y a des enfants dans la compagnie, ou qui accompagnent les artistes, éviter de présupposer que…
- c’est forcément une femme qui s’en occupe ;
- que toute femme est forcément sa mère ;
- que l’enfant a forcément deux parents d’un genre différent ;
- etc.
Installer des espaces pour changer les bébés dans toutes les toilettes…
Qu’elles soient destinées au public ou non !
Prévoir un espace avec lavabo + toilettes où il est possible de s’enfermer à clef
, dans toutes les loges et toutes les toilettes (y compris celles pour le public).
Installer des poubelles dans toutes les toilettes individuelles.
Dégenrer aussi les métiers de l’institution :
- parler des techniciennes et techniciens ;
- des chargés et chargées de production ;
- des régisseurs et régisseuses ;
- etc.
Voire utiliser la règle du « féminin l’emporte », elle n’est pas fausse en français, simplement tombée en désuétude !
Deux mots d’ordre s’impose ici :
- éviter de préjuger du genre des personnes
- et faire de la collaboration un espace-temps non sexiste.
Se former collectivement pour lutter contre le sexisme et les LGBTphobies à tous les niveaux :
- dans les documents officiels écrits ;
- la communication interne ;
- la communication externe ;
- les blagues du coin fumeur·ses ;
- la déco ;
- la programmation ;
- les private jokes ;
- …
Prendre l’habitude de demander les pronoms que les artistes et leurs équipes préfèrent utiliser, puis :
- Les partager à l’équipe de la structure ;
- Les indiquer partout où c’est utile : étiquette de casier / loge, fiche technique de montage…
- Et encourager tout le monde à les respecter ;
- Reprendre simplement les personnes qui se trompent, sans en faire un sujet.
Se former collectivement à l’accueil de la transidentité
: cela pourrait même avoir un intérêt au sein de la structure !
Tenir compte de la potentielle parentalité des artistes – quel que soit leur genre – pour fixer des rendez-vous
:
- Demander simplement si cela joue sur leur disponibilité ;
- Faire attention aux vacances scolaires, mercredis, etc. ;
- Permettre un accueil des jeunes enfants pendant les rendez-vous fixés avec leur(s) parent(s).
NB : cela peut également être utile pour les aidant·es !
Pour les lieux de résidence
:
- Offrir la possibilité d’accueillir un·e ou des enfants de l’artiste accueilli·e en résidence ;
- Rechercher des modes de garde voire des écoles alentour ;
- Faciliter leur accès pour les enfants des artistes.
S’assurer que tout le monde a été informé·e, ou a eu accès aux mesures prises
:
- Un envoi de mail ne suffit pas !
- Aménager des espaces-temps de présentation et de commentaires sur ces mesures.
Faire des points réguliers à différentes échelles de l’équipe
:
- en binômes
- en équipes réduites
- par service
- et pour l’ensemble des équipes
sur la mise en place de nouvelles procédures d’accueil / de résidence. Se demander :
- qu’est-ce qui fonctionne ?
- qu’est-ce qui est à améliorer ?
- qu’est-ce qui est à ajouter ? à retirer ?
Dès qu’une ou plusieurs de ces actions sont en place, il est important de les communiquer aux personnes concernées, de la manière la plus transparente possible. Y compris en indiquant ce qui est en test ou en phase de réflexion : cela montre aussi la bonne volonté de la structure.
Dans les appels à projets, indiquer la procédure pour obtenir un retour destiné aux personnes non retenues…
Et répondre aux demandes !
Dans toutes les pages du site internet destinées aux artistes :
- indiquer les mesures phares quant à l’accueil des familles ;
- les grandes étapes d’une collaboration ;
- indiquer notamment si les dossiers artistiques envoyés « à froid » à la direction artistique seront étudiés et comment ;
- dégenrer la langue également dans ces supports.
Dégenrer également sa communication externe, la langue inclusive a sa place partout
:
- site internet ;
- newsletters ;
- réseaux sociaux ;
- affiches ;
- cartons d’invitation ;
- feuille de salle ;
- etc.
Au fur et à mesure de la mise en place de ces actions, réactiver le processus d’amélioration continue présenté dans la partie « Faire un état des lieux ».
Attention : la mise en place d’indicateurs peut être utile pour observer l’évolution et l’efficacité d’une action. Mais elle ne doit pas prendre le pas sur l’action elle-même. Si les indicateurs ne sont pas opérants, ne pas hésiter à en changer. Pour l’équipe, il est important de garder une trace qualitative (même en deux mots) des ressentis négatifs.
Créer et actualiser un mini questionnaire destiné aux artistes accueilli·es
: maximum 3 questions fermées (réponse de 0 à 5) + une question ouverte ou un champ de commentaire libre
Mettre en place des sessions de travail sur ces questionnaires
: analyses, discussions, mise en place d’actions en vue de l’amélioration partout où cela est possible.
Mettre en place un processus similaire pour suivre et améliorer l’expérience des équipes de l’institution dans l’accueil des artistes
: noter les commentaires liés à l’accueil, les frictions éventuelles, les actions à mettre en place pour améliorer le travail des équipes.
Faire un suivi sur un long terme
: sur une à deux saisons culturelles, il est possible de voir si amélioration il y a dans le ressenti des équipes et dans les retours des artistes.
des actions
"A faire"


Je personnalise mon PDF avec mon nom et mon logo (c'est facultatif) :
J'upload mon logo
(taille recommandée : 2 Mb)
Les ressources
[Voir également dans la boîte à outils, au bas de cette page]
Ressources issues de la facilitation en milieu professionnel :
Elles peuvent inspirer autant les retours faits entre artistes et institution, que ceux faits au sein d’une équipe ou entre pairs !
- Le Guide du feedback des Facilitatrices, pour un usage plutôt en équipe
- Le Mur d’humeurs, un outil de photolangage pour décrire un ressenti
- La Roue des émotions
Faire des retours dans l’art :
- Le Guide du retour
- A Film About Feedback, développé par l’école d’art DASart en collaboration avec Karim Benammar
- How artists are chosen ? Exclusivité, travail précaire et asymétries dans les compétitions artistiques, par Wages For Wages Against (Tiphanie Blanc & Ramaya Tegegne), avec les contributions de Stirnimann-Stojanovic et Amandine Gay, édité par L’Amazone & Privilege, 2022. Accessible en anglais sur le site de WFWA
- Recommandations tarifaires de l’ASPRO 2025, association luxembourgeoise des professionnel·les du spectacle vivant, très souvent mis à jour
- Guide pour la contractualisation et la rémunération des artistes en Bretagne, Art contemporain en Bretagne, 2025
- Article de 2024 présentant des référentiels de rémunération des travailleur·ses des arts visuels en France et en Suisse
- Pour une meilleure prise en compte de la vie familiale des résident·es, guide élaboré par Arts en résidence et [Re]production, pour les arts visuels en France, 2023
- Charte d’accueil et de respect des équipes artistiques C.A.R.E, 2022
- Pour réfléchir au lien entre enjeux de pouvoir, alcool et sociabilité en milieu artistique : « Faut-il boire pour se faire une place dans le milieu de l’art ? », épisode 17 du podcast Pourvu qu’iels soient douxces par Jeunes Critiques d’art et Projets Média
- Le site d’autosupport pour consommateur·rices de produits psychotropes Psycho-actif propose notamment un quiz pour s’autotester et des pratiques de réduction des risques
- Guide de voyage pour planer sans trop se crasher, brochure communautaire autoéditée
- Sur l’accueil et la collaboration avec des personnes en situation de handicap : Ce que les corps déviants enseignent, conférence gesticulée de Mathilde François dans le cadre de la journée professionnelle du réseau Tram (arts visuels, Île-de-France), 2024
- Outil d’aide à la traduction de textes en français facile à lire et à comprendre (FALC)
- Pour des ressources au Luxembourg, se rapprocher du Centre LGBTIQ Cigale
- Sur les transidentités, l’association Outrans, association d’autosupport trans, dispense des formations et fournit du matériel de sensibilisation
- Pistes pour une écriture inclusive sans point médian
Fiche conçue par Géraldine Miquelot avec l’aide de Marie Chevalier et Robyn Chien.

La boite à outils de DéDé
Quelques fiches pratiques autour de la question du retour (feedback) en équipe, entre institution et artistes, ou entre pairs artistes.




